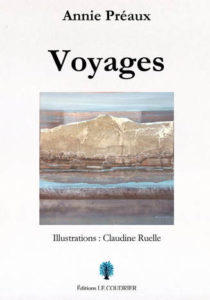 Annie Préaux, Voyages, Mont Saint-Guibert, Le Coudrier, 2017,104 p. (16€)
Annie Préaux, Voyages, Mont Saint-Guibert, Le Coudrier, 2017,104 p. (16€)
Quête de soi et du monde
Ce que parcourt Annie Préaux est une vie. Elle la pratique dans une géographie à la fois concrète et philosophique. Ce sont des mots placés dans des endroits variés. Ils s’interrogent à propos de leur mensonge et de leur vérité, de la nécessité de les exprimer ou du silence où les enfermer, de l’intérêt de savoir mais aussi parfois du bienfait plus ou moins superficiellement rassurant d’ignorer.
Ce balancement perpétuel entre des actes antagonistes se situe dès l’abord entre le fait de partir, de quitter opposé à celui de rester, de demeurer. Le doute étant plus fructueux que la certitude immuable, l’homme « Trouvera-t-il enfin / À l’aplomb d’un ciel épuisé / Quelque chose qui ressemble / À ce qu’il cherche / Depuis si longtemps », lui qui « cherche un vide / Qui attendrait son plein », lui espérant « y trouver quelqu’un / D’infiniment cherché / Le personnage d’un livre » ?
Rien n’est moins sûr puisque « La vérité se dérobait / Dans la splendeur/ Des lieux / Qu’on devinait fictifs / Inventés / Pour une nouvelle naissance ». Rarement encombré par des localisations géographiques précises, ce périple prend des allures d’universel. Il sera aussi bien de type pèlerinage que d’exil. Ce ne peut être une randonnée comme celle, superficielle, des touristes. Ce doit être confrontations sans racisme entre ethnies, perceptions de ce qui ronge l’équilibre naturel de l’univers. Ce sera manière de se connaître mieux soi, même s’il ne s’agit pour un humain que de « Quelque chose qui ressemble /À ce qu’il cherche / Depuis si longtemps ».
Cette poésie se construit au moyen de vocables simples, « de grand dépouillement », sans volonté de miser sur des effets littéraires. Moins nombreuses que les comparaisons, les métaphores n’abondent pas mais présentent des images fortes, telles que « ce barda d’illusions », «sa peau tatouée de silence », un « sourire de paille », « un œil d’obsidienne », une « mort acrobate », des « villes pieuvres », « sous l’épervier d’éperdument », « le pavé d’un racolage de façade »…
Les adjectifs ont souvent fait la chasse aux clichés grâce aux couleurs (« la paix mauve », « souvenirs carmin », « larmes noires »), grâce à l’insolite du regard posé (« obèse serpent », « automnal duvet », « banalité morte», «fissures gratuites», « déraison clignotante », « oisillon précoce »), grâce aux tensions d’oxymores (« fenêtres opaques »). L’ensemble témoigne d’une quête permanente, d’un besoin de dépasser les incertitudes sans s’enliser dans des croyances.
Les illustrations picturales de Claudine Ruelle, paysages cousins de l’abstraction, disent une luminosité ocre, des aspérités d’écorchures, une permanence temporelle qui ne craint pas la fragilité. Elles sont mariage avec les mots, langage visuel qui les complète sans redites, jamais illustration servile d’un lieu identifiable sur une carte.
Michel Voiturier
