Barbara Y.Flamand, L’odeur, Bernardiennes (www.bernardiennes.be), 2014, 150 pp.
Barbara Flamand a réussi, avec ce roman, un récit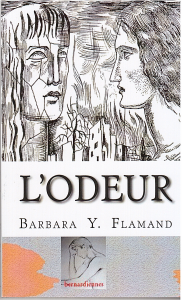 plein de saveur et d’alacrité. La critique sociale s’y inscrit en réflexions acides, d’un bon sens parfois renversant envers les idées reçues, et des variations de ton à vous couper le souffle…Le nonsense y côtoie le vaudeville, et en ces 150 pages, les problèmes essentiels de notre société, de notre monde sont abordés, traités, maltraités, non point résolus, mais remis sur leurs pieds, raclés, lessivés, décapés. Pas de temps morts, le lecteur est lui aussi traité sans ménagements, et, jusqu’à la fin, le souffle ne fléchit pas.
plein de saveur et d’alacrité. La critique sociale s’y inscrit en réflexions acides, d’un bon sens parfois renversant envers les idées reçues, et des variations de ton à vous couper le souffle…Le nonsense y côtoie le vaudeville, et en ces 150 pages, les problèmes essentiels de notre société, de notre monde sont abordés, traités, maltraités, non point résolus, mais remis sur leurs pieds, raclés, lessivés, décapés. Pas de temps morts, le lecteur est lui aussi traité sans ménagements, et, jusqu’à la fin, le souffle ne fléchit pas.
Ainsi, à la page 15, un dialogue vaudevillesque, sans pitié pour les personnages. Sa spécialité: le piquant, le saugrenu, le sucré-salé, et aussitôt après, p.17, la pantomime. A la page 24, une ancienne dresseuse de phoques rencontre un président (spectacle-réalité?). Page 24, une ironie acerbe et sereine, qui purifie les atmosphères plutôt faisandées où se déroule son récit. Une héroïne pulpeuse qui fait une carrière dans la pub pour les produits bio. Algues amincissantes, modèles aux joues creuses…Quelle galerie! Et avec cela, des phrases courtes, incisives, faussement naïves, un ton qui rappelle un peu celui du Candide de Voltaire: l’air de ne pas y toucher.
Epinglons ainsi, p.37: On fait des présidents avec tout, même des philosophes. Page 40: On peut faire beaucoup de choses avec un philosophe et une maquilleuse. Page 67: le continent remplace la nation. Page 107: Si l’économie dispose, à quoi bon la philosophie?Tout est passé au crible, même nos querelles linguistiques. Et puis, l’absurde: Qui peut s’imaginer un rossignol chez un rhinologue? Et ce morceau de bravoure, les effets de la musique sur le président.
Les idées qu’elle défend, sans avoir l’air d’y toucher, concernent ce qu’il y a de plus grave dans nos sociétés. Nous ne cessons de nous présenter comme les mainteneurs du monde libre, mais en réalité, c’est l’économie, avec ses lois de fer, qui dirige notre monde libre. Et il cache en ses bas quartiers les misères qu’il engendre. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, disait Leibniz. Et Candide démontre brillamment que ce meilleur des mondes n’est qu’une belle formule qui sert de paravent aux pires misères. Supprimer de la main d’œuvre, remplacer partout où c’est possible l’homme par la machine, même si cela crée un chômage galopant, même si cela détruit le tissu social de nos villages et de nos villes, cela s’inscrit dans la colonne « Bénéfices » de notre meilleur des mondes. De même, obliger les gens à changer de poste de travail tous les jours, engager à bas prix de la main d’œuvre étrangère, délocaliser les usines, pratiquer sans la moindre vergogne la sous-traitance dans les pays pauvres, tout cela aussi s’inscrit dans la colonne des gains. Les dégâts collatéraux ne sont pas pris en considération.
La terre a tremblé à Lisbonne au temps de Voltaire. Aujourd’hui, elle n’a pas fini de trembler. Oui, mais l’odeur? me direz-vous. L’odeur, elle est partout. Elle accompagne toute cette pourriture au milieu de laquelle nous vivons. Le président le dit lui-même, p.147: Le monde n’est pas que vulgaire, il est puant et ce que je sens, c’est cette puanteur. Cette odeur, c’est le reflet de ses pensées, de certains de ses projets. Il la transporte partout avec lui, et elle finit par empoisonner la terre.
Joseph Bodson
