Marc Bailly, La Belgique imaginaire, Tome 2, Louvain-la-Neuve, Academia/L’Harmattan, 2016, 284 p.marc baillymarc bailly
Pour compléter le premier volume consacré à la littérature ‘fantastique’ francophone de Belgique, Marc Bailly a rassemblé des nouvelles de réalisme magique, d’épouvante, de fantasy, de science-fiction, de dystopie ou d’uchronie, toutes sorties de l’écriture des héritiers de Jean Ray, Thomas Owen, Jacques Sternberg et autres spécialistes des mystères inexpliqués, des imaginaire débridés.
Baronian (1942) conte en quelques pages une sorte de vengeance posthume. Sous forme de légende, Rose Berryl (1982) nous rappelle que la mort est inéluctable et que son travail quotidien n’est pas de tout repos (éternel). Ambre Dubois (1979) revient au passé, au temps de ce bon vieux Sherlock Holmes, à Londres, peu après l’invention du cinématographe. Il est question de Lucifer, le vrai, pas celui récemment ressuscité par une série télévisée étasunienne. Celui à qui un humain peut vendre son âme.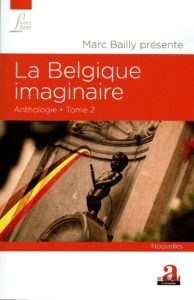
Chez Pascal Blondiau (1965), c’est la potentialité des matous à vivre neuf vies qui fait la trame de l’histoire. Pour sa consœur, Doris Facciolo (1985), le chat est également le thème d’une nouvelle dans laquelle les pensionnaires d’une seigneurie disparaissent les uns après les autres. Christo Datso (1958) vous embarque de manière passionnée dans des mondes parallèles, là où l’intelligence artificielle officie, du côté des « surfaces pliées du temps », vers une programmation mathématique baptisée « chronodynamique», à partir du postulat que, « si le temps est une opération de l’esprit, il est calculable, et s’il est soumis aux règles du monde physique, il devient attaquable ». Le résultat étant « la transformation locale de l’espace euclidien en une variété de dimension quatre aux propriétés singulières ». Alain Le Bussy (1947-2010) plonge dans le conte, dans le mythe du savant maîtrisant la vie sans trop se préoccuper des effets indésirables, comme tant de chimistes dans la vie réelle.
Avec humour, Alain Dartevelle (1951-2017) se transporte là « où l’art de guérir, résolument devenu de l’ordre du virtuel, a tout d’un jeu de l’esprit, d’un jeu de société ». L’histoire sortie de l’imagination d’Adrianna Lorusso (1946) est d’abord aussi un moment d’humour. Celui qui ose s’attaquer aux idées reçues véhiculées par les légendes traditionnelles et du coup se permet de poser la question essentielle : qu’est-ce qui existe et qu’est-ce qui n’existe pas ?
Philipe Dumont (1954) manie avec brio la verve d’une dérision acidulée qui s’accommode aussi bien du suicide que de la vie dans l’au-delà. Pierre Efratas (1951) est son digne frère littéraire. Le dieu censé nous gouverner est un as du marketing lorsqu’il s’agit d’entretenir la croyance que les hommes ont en lui. D’où une parodie de la Genèse dans laquelle Lilith joue le rôle d’Eve en faveur d’un créateur macho. Quant à Nadine Monfils (1953), avec « La fée pin-up », elle use de la fantaisie (et non la fantasy) avec délicatesse afin de nous persuader qu’il convient de profiter de tous les petits cadeaux qu’offre la vie.
Valérie Frances (1975) campe un héros qui, faute d’audace, collectionne les poupées plutôt que les femmes. Mais continue à rêver à de vraies partenaires sexuelles. Daniel Garot (1974) se penche sur l’enfant roi pour aboutir à la sanglante logique d’une éducation déboussolée. Dominique Leruth (1960-2015) mise sur l’obsession, dans une atmosphère de région accueillant du mieux possible des réfugiés. La limpidité du récit rend davantage horrifique le passage de l’imaginaire à la réalité des coutumes locales.
Avec faconde, Mythic (1947) reprend le vieux thème du voyage dans le temps. Son héros désire se débarrasser d’Hitler avant la catastrophe de la seconde guerre mondiale. Mais est-il possible de modifier a posteriori le cours de l’Histoire ? Daph Nobody (1975) réfléchit sur le double, thématique récurrente dans la SF. Il y expérimente le fait que « la violence agit comme la séropositivité ». Et sa réflexion n’a rien de rassurant. Anne Richter (1939) s’interroge, quant à elle, sur la dualité de l’artiste.
Bérengère Rousseau (1981) place son personnage devant le jugement dernier selon un rituel emprunté à l’Égypte ancienne. Il doit y répondre à propos d’un meurtre. Reste à découvrir s’il peut, et à quel titre, bénéficier d’une seconde chance pour se réinsérer dans la société d’aujourd’hui.
Embarqué vers Venise, Michel Rozenberg (1959) promène, dans la ville et ses ruelles, un célibataire transi qui se laisse hypnotiser par une femme finalement révélée fatale dans tous les sens du mot. Christian Simon (1973) s’incarne dans un individu atteint d’hypermnésie, c’est-à-dire de mémoire phénoménale qui retient tout de son vécu. Deux mondes, ici, s’affrontent : celui de la réalité familiale et celui de l’imaginaire intérieur. À travers un style plutôt lyrique, se pose la question du choix à faire entre ces univers incompatibles.
Dominique Warfa (1956) examine les peurs irraisonnées qui frappent un pays – en l’occurrence la Suisse – et dont les autorités tentent de se débarrasser en décrétant des législations restrictives en opposition avec la démocratie. Il met aussi en lumière les risques encourus lorsque des découvertes permettent d’envisager de modifier le psychisme d’un être, de le pousser au-delà de ses limites, comme autrefois avait procédé Frankenstein. Barbara Wesoly (1986) reste coincée dans « L’éternité d’un instant ». Elle tente de concrétiser l’absence inhérente à la mort d’un être aimé au sein d’un silence, au beau milieu d’une fin qui serait un commencement.
Entre racines du passé et bourgeons du futur, ces nouvelles témoignent que les mystères persistent, que les rêves risquent de se briser, que l’imaginaire actuel est aussi riche que celui d’hier ou de naguère. Qu’il véhicule les problèmes existentiels de toujours, les peurs immémoriales.
Michel Voiturier
